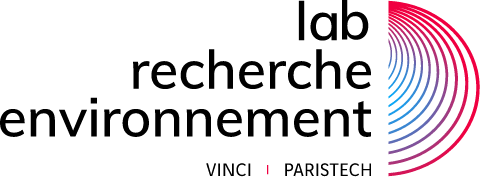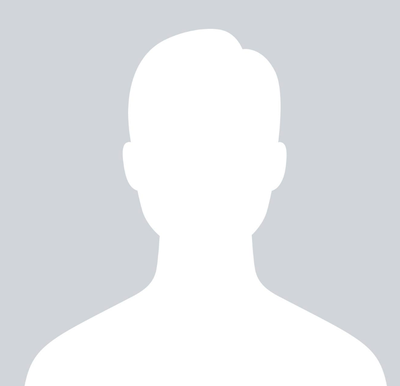Les jardins domestiques comme socio-écosystèmes : des propriétaires et leurs pratiques à la biodiversité et sa conservation
Contexte et enjeux :
L’urbanisation est l’une des principales causes de la perte de biodiversité, d’une part via la destruction et la fragmentation des habitats semi-naturels, et d’autre part via les pressions exercées sur les fragments d’habitats restants : espaces verts urbains restants. Ces espaces soutiennent la biodiversité urbaine et fournissent des services écosystémiques essentiels aux citadins (notamment en termes de culture et de santé). Dans ce contexte, il est essentiel d’identifier des modes de gestion des espaces verts urbains qui concilient la préservation de la biodiversité avec les perceptions, besoins et usages des citadins. Il est également nécessaire d’identifier les contributions respectives des différents types d’espaces verts à la conservation des espèces au sein du tissu urbain.
Objectifs et méthodes :
Ce projet de thèse se concentre sur les jardins domestiques, un type d’espace vert urbain encore peu étudié. Les jardins présentent pourtant un fort potentiel pour la conservation de la biodiversité en ville, en tant que refuges pour les espèces sauvages, mais également en tant que lieux d’interaction quotidien entre les citadins et le vivant. De plus, leur étude offre une opportunité d’identifier des stratégies de conservation transposables à d’autres espaces verts urbains.
Par une approche interdisciplinaire en écologie et en psychologie de l’environnement, ce projet s’organise autour de trois objectifs. Le premier est de comprendre comment la gestion et la configuration des jardins influencent la diversité taxonomique et fonctionnelle des communautés végétales ainsi que les ressources en nectar qu’elles fournissent aux insectes floricoles. Le second est d’identifier les barrières et opportunités existantes pour la conservation de la flore dans les jardins, notamment en déterminant comment les pratiques ou activités associées aux jardins peuvent enrichir la connexion à la nature et la biophilie des jardiniers. Le troisième est d’évaluer l’apport des jardins privés au sein du tissu urbain pour la conservation de la flore (à une échelle d’étude locale) et d’un groupe de pollinisateurs : les papillons (à une échelle spatiale plus large).
Laboratoire ESE
- À propos
- Chercheurs